Clarifier les objectifs, la condition sine qua non pour réussir une séance d’intelligence collective
« On se réunit, on réfléchit ensemble, et on verra bien où ça nous mène. »
Voilà une phrase qui, malgré ses bonnes intentions, porte en elle les germes de nombreuses dérives.
Car l’intelligence collective, aussi puissante soit-elle, ne peut déployer son potentiel que si elle repose sur des fondations solides.
La première de ces fondations, c’est la clarté des objectifs. Avant de réunir un groupe, avant même de penser aux méthodes d’animation, il est indispensable que commanditaire et facilitateur se mettent d’accord sur une chose : pourquoi précisément réunit-on ces personnes ?
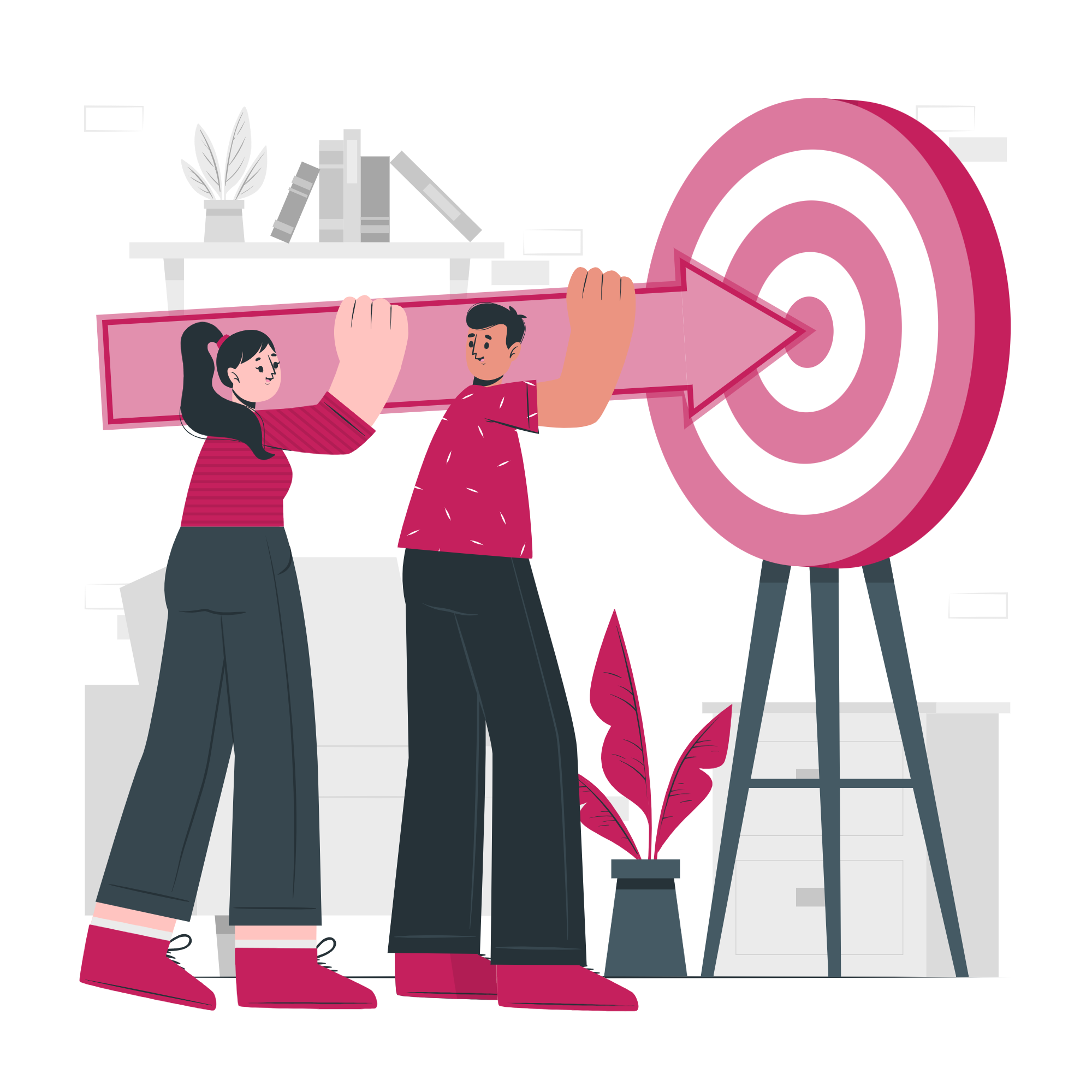
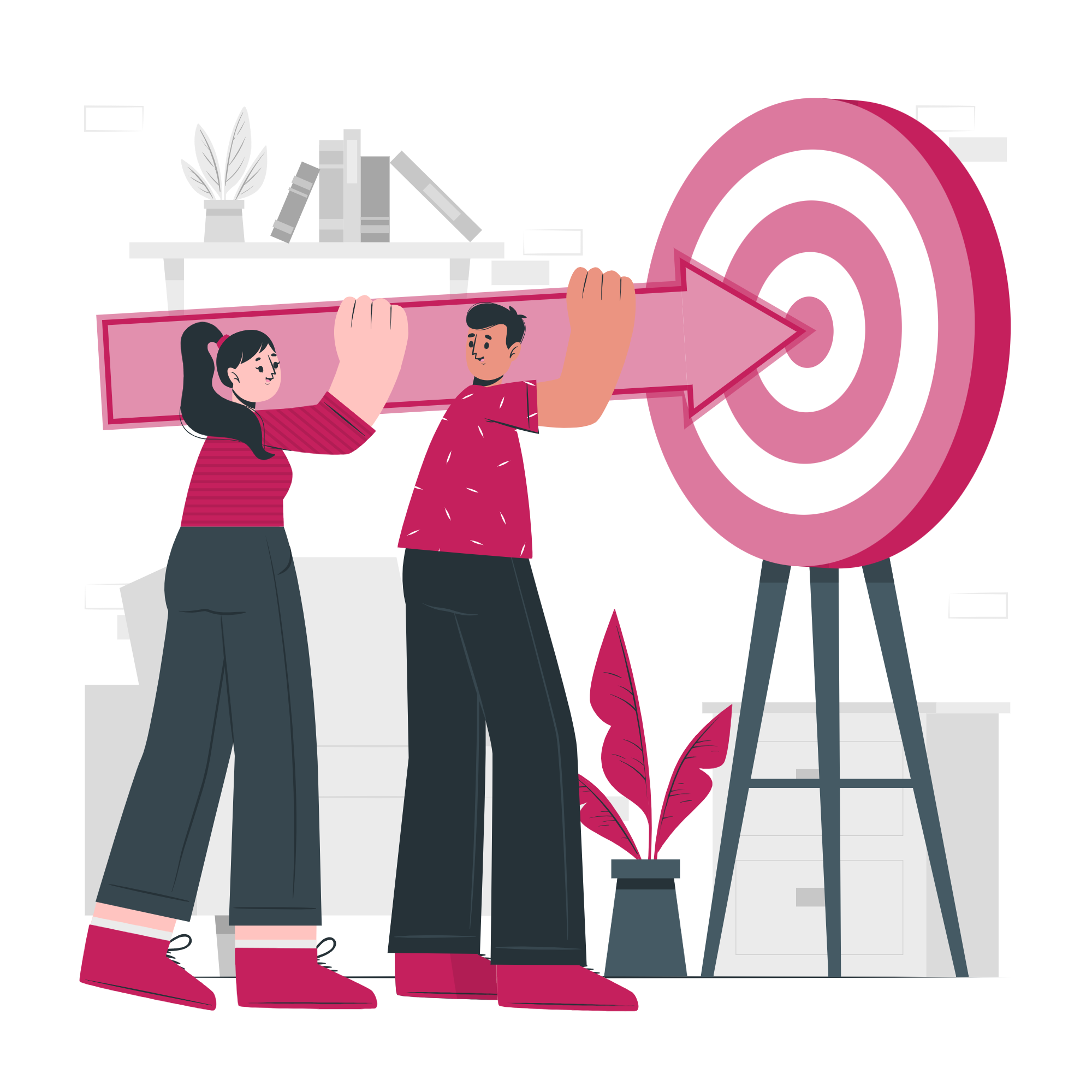
1- L’objectif : plus qu’une formalité, un contrat de confiance
Formuler l’objectif en une phrase simple
La clarification des objectifs commence par un exercice apparemment simple, mais souvent négligé : formuler en une phrase simple et claire ce que l’on souhaite obtenir.
Cette phrase doit répondre à la question : « À la fin de cette séance (ou de ce cycle), qu’espérons-nous produire, décider, découvrir… ? »
La formulation de l’objectif est essentielle mais elle ne doit pas être un carcan en bridant les idées innovantes. Elle est un point de départ, un cap commun, un contrat de confiance qui sécurise le commanditaire, le facilitateur et le groupe mais doit laisser l’espace pour que l’intelligence collective puisse aussi s’exprimer.
Il s’agit peut-être plus à ce stade d’une intention que d’un objectif trop précis.
Comprendre le contexte et l’enjeu
Au-delà de l’objectif, il est essentiel de partager le contexte qui motive la démarche.
- Pourquoi cette demande arrive-t-elle maintenant ?
- Quels événements, constats ou difficultés l’ont déclenchée ?
- Quel est l’enjeu stratégique ou opérationnel sous-jacent ?
Ce contexte aide le facilitateur à adapter son approche et permet aux participants, une fois informés, de mieux saisir les enjeux et de s’engager pleinement.
L’intelligence collective se nourrit de sens : donner du sens, c’est déjà mobiliser l’énergie du groupe. Clarifier les enjeux c’est finalement neutraliser les “fausses routes” et les nécessaires déceptions qui en découlent.
2- Définir un cadre éthique : les conditions de la vraie intelligence collective
Clarifier les objectifs ne suffit pas. Il faut aussi s’assurer que les conditions du travail collectif sont réunies.
C’est ici que se joue un contrat éthique entre le commanditaire et le facilitateur, un contrat qui garantit que l’on fait appel à l’intelligence collective pour de bonnes raisons, et non pour valider une décision déjà prise ou pour donner une illusion de participation.
Éviter les biais de composition
Un premier point de vigilance concerne la composition du groupe. Qui participe à la séance ?
Si seuls des experts d’un même domaine ou des managers d’un même niveau sont présents, le risque est grand de reproduire une vision unique, voire de légitimer une orientation déjà décidée.
Le facilitateur doit ici être force de proposition pour garantir une représentation plurielle : différents niveaux hiérarchiques, différentes expertises, différents points de vue.
L’intelligence collective naît de la diversité des regards, et non de leur uniformité. On ne le dira jamais assez !
Garantir la liberté d’expression
L’intelligence collective repose sur un principe fondamental : chacun doit pouvoir s’exprimer librement, sans crainte de jugement ou de répercussions.
Cela implique de clarifier, dès le départ, la marge de manœuvre réelle du groupe.
Si certains sujets sont « non négociables », il faut le dire clairement. Si des décisions sont déjà prises en partie, il faut les expliciter. Rien n’est plus dommageable qu’un groupe qui découvre, en fin de parcours, que ses propositions ne seront pas prises en compte.
Mieux vaut une marge de manœuvre restreinte mais assumée, qu’une fausse liberté qui génère frustration et désengagement.
Une question essentielle à poser au commanditaire :
« Êtes-vous ouvert à une remise en question de certaines orientations, si le groupe fait émerger des alternatives pertinentes ? »
La réponse à cette question en dit long sur la sincérité de la démarche.
Respecter l’ADN de l’intelligence collective
Faire appel à l’intelligence collective, c’est accepter de lâcher prise et de remplacer le contrôle par la responsabilité.
C’est donc partir du principe que le groupe a la capacité de produire des réponses et des contenus, c’est accepter que ces derniers puissent déranger, car « Toute véritable transformation sera précédée d’un grand moment d’inconfort. C’est là le signe que vous êtes sur le bon chemin » (Ajahn Chah).
Le commanditaire doit comprendre et accepter cette posture : ne pas imposer, ne pas orienter, ne pas prédéterminer les résultats.
Le rôle du facilitateur est justement de protéger cet espace de liberté créative, tout en accompagnant le groupe vers l’objectif défini avec le commanditaire.
C’est un double engagement qui demande de la confiance mutuelle. Si le commanditaire n’est pas prêt à cette posture, il vaut mieux renoncer à la démarche d’intelligence collective et opter pour un autre mode de travail.
Clarifier le reporting et éviter le sur-formalisme
Enfin, il est important de s’entendre sur la forme et la régularité du reporting.
Comment les résultats des séances seront-ils communiqués ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ?
Ici, un piège guette : le sur-formalisme. Des comptes-rendus trop lourds, trop détaillés, trop « corporate » peuvent tuer la dynamique et créer une distance entre le travail du groupe et sa traduction écrite.
Privilégier des restitutions simples, visuelles si possible, qui capturent l’essentiel sans étouffer la vitalité des échanges.
3- Les bonnes questions à poser pour un cadrage réussi
- Quel est l’enjeu principal que vous souhaitez aborder lors de cette séance ou de ce cycle ? Cela permet de vérifier que l’on parle bien de la même chose et de mesurer l’importance du sujet.
- Quels sont les objectifs concrets, mesurables ou stratégiques que vous souhaitez voir aboutir ? Cette question force à passer du vague au précis, du général au tangible.
- Quel est le contexte qui amène cette demande ? Comprendre le « pourquoi maintenant » aide à affiner la démarche et à anticiper les attentes du groupe.
- Quelles interactions ou dynamiques souhaitez-vous favoriser ? Collaboration, créativité, prise de décision, résolution de conflit… Chaque intention appelle des méthodes différentes.
- Qui sont les participants concernés ? C’est ici que le facilitateur peut proposer d’élargir ou d’ajuster la composition du groupe pour garantir une vraie diversité.
- Êtes-vous ouvert à une reformulation ou adaptation de l’objectif en fonction des attentes émergentes du groupe ? Cette question teste la souplesse du commanditaire et sa capacité à accueillir l’imprévu.
En guise de conclusion
Ces questions sont une invitation au dialogue, un moyen de co-construire dès le départ un cadre qui servira tout le monde.
Au terme de cette phase de cadrage, le facilitateur doit pouvoir se poser une dernière question, peut-être la plus importante :
« Ai-je envie d’animer cette séance dans ces conditions ? ».
Car si les réponses du commanditaire révèlent un manque de clarté, une marge de manœuvre inexistante, ou une volonté de contrôle trop forte, le facilitateur a le droit, et même le devoir, de renoncer.
Animer une séance d’intelligence collective sans les conditions adéquates, c’est prendre le risque de décevoir tout le monde : le commanditaire, les participants, et soi-même.
L’intelligence collective est un acte de confiance. Elle demande du courage, de la transparence, et une volonté sincère de faire ensemble.
