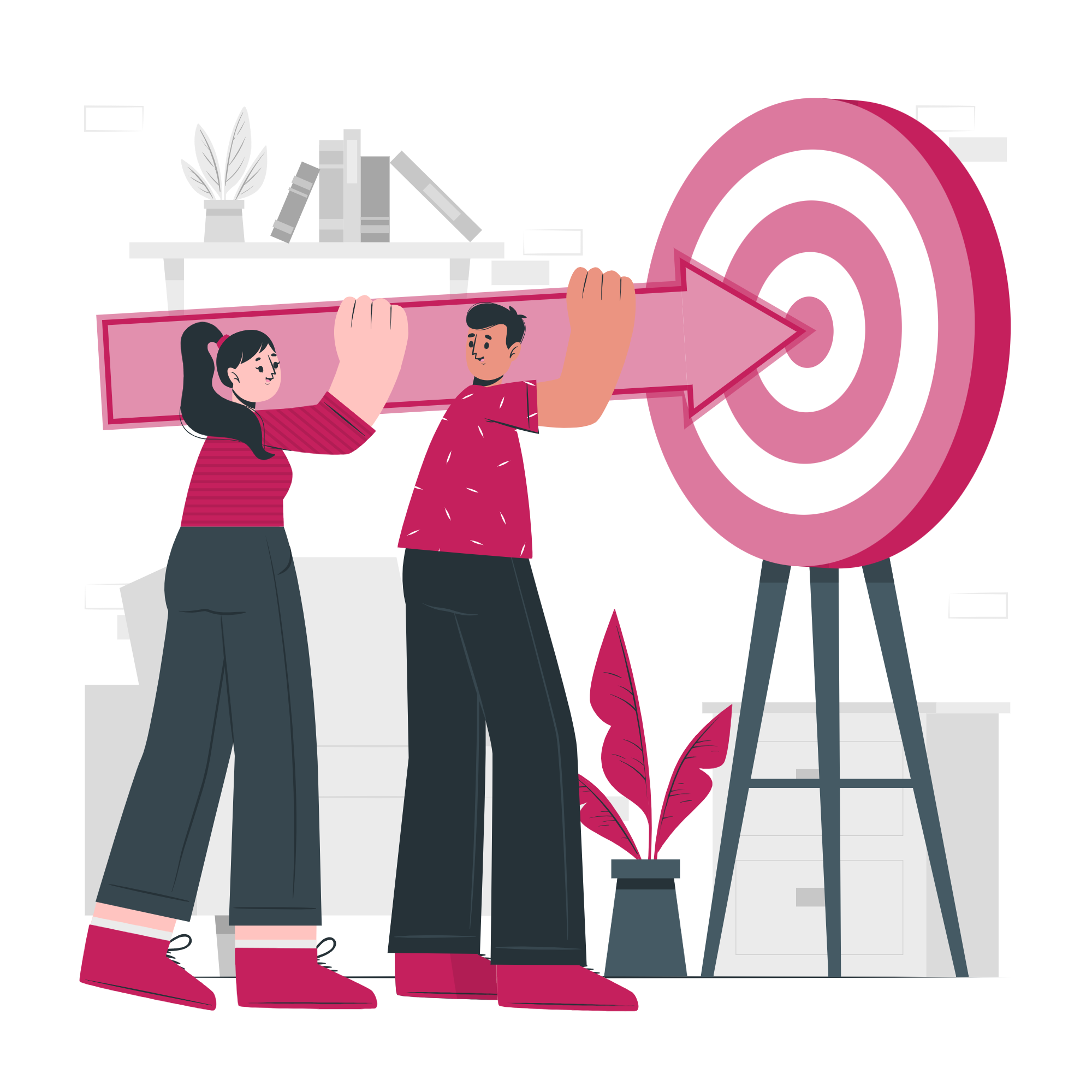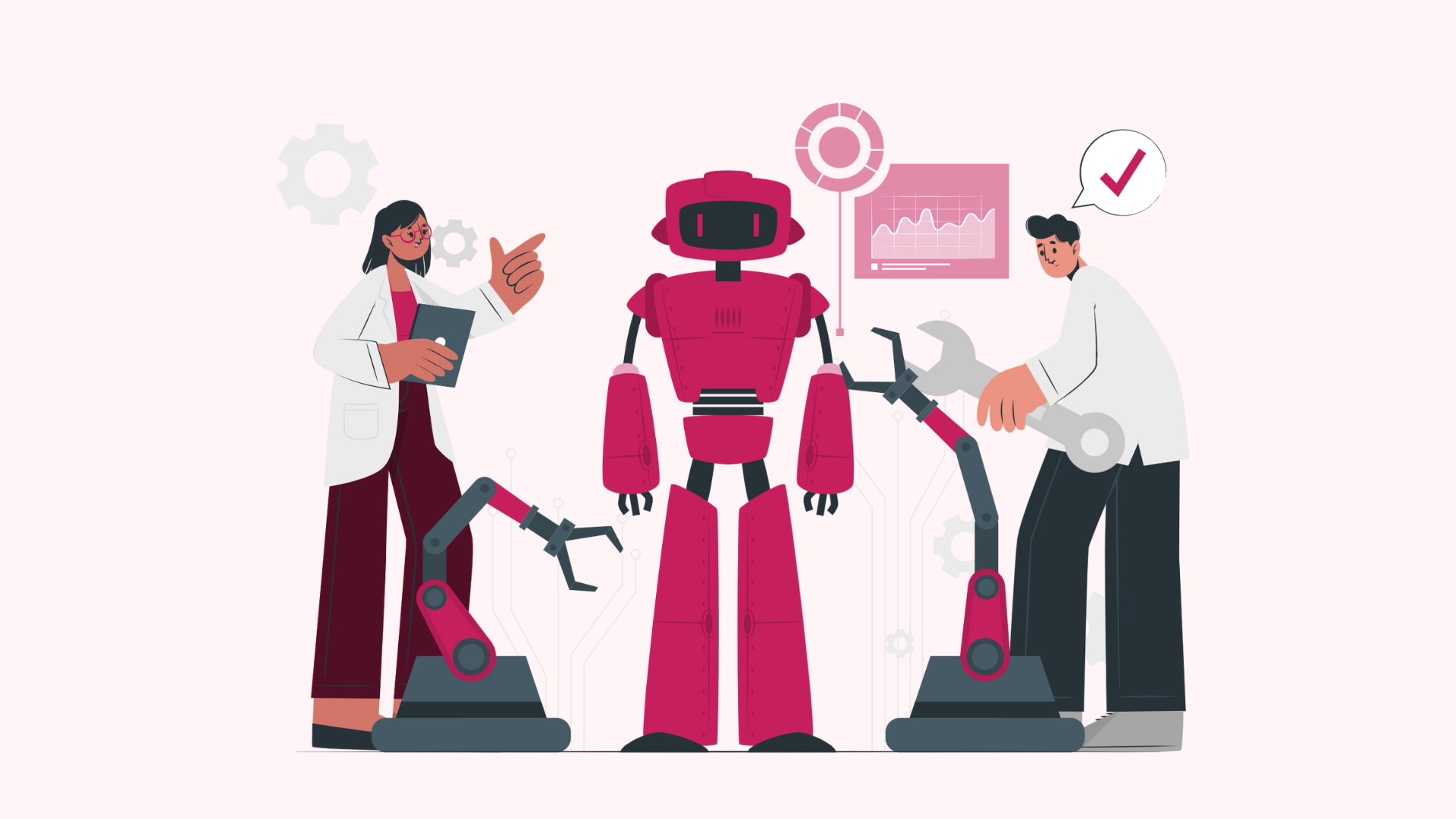Les structures libératrices
Les structures libératrices (Liberating structures)
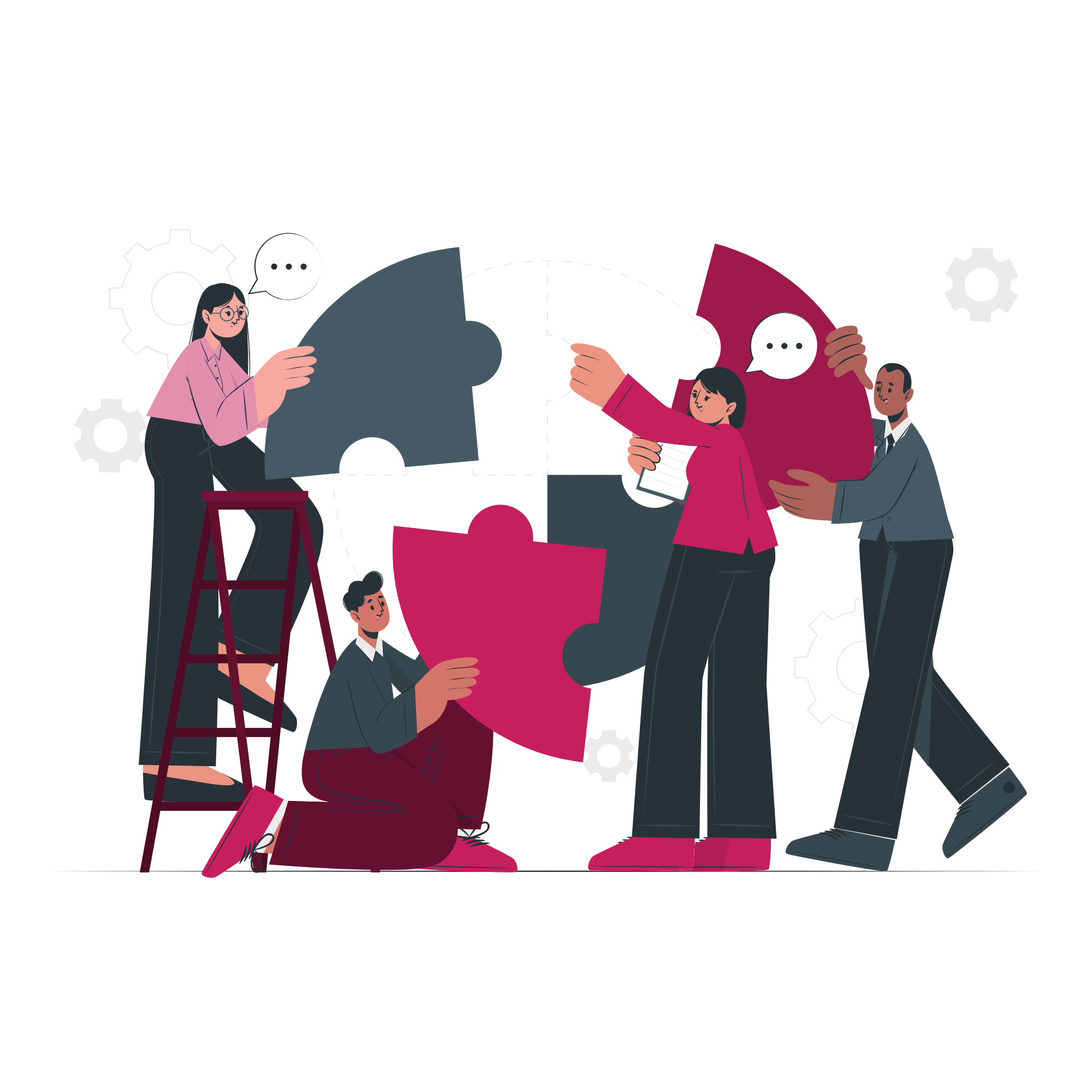
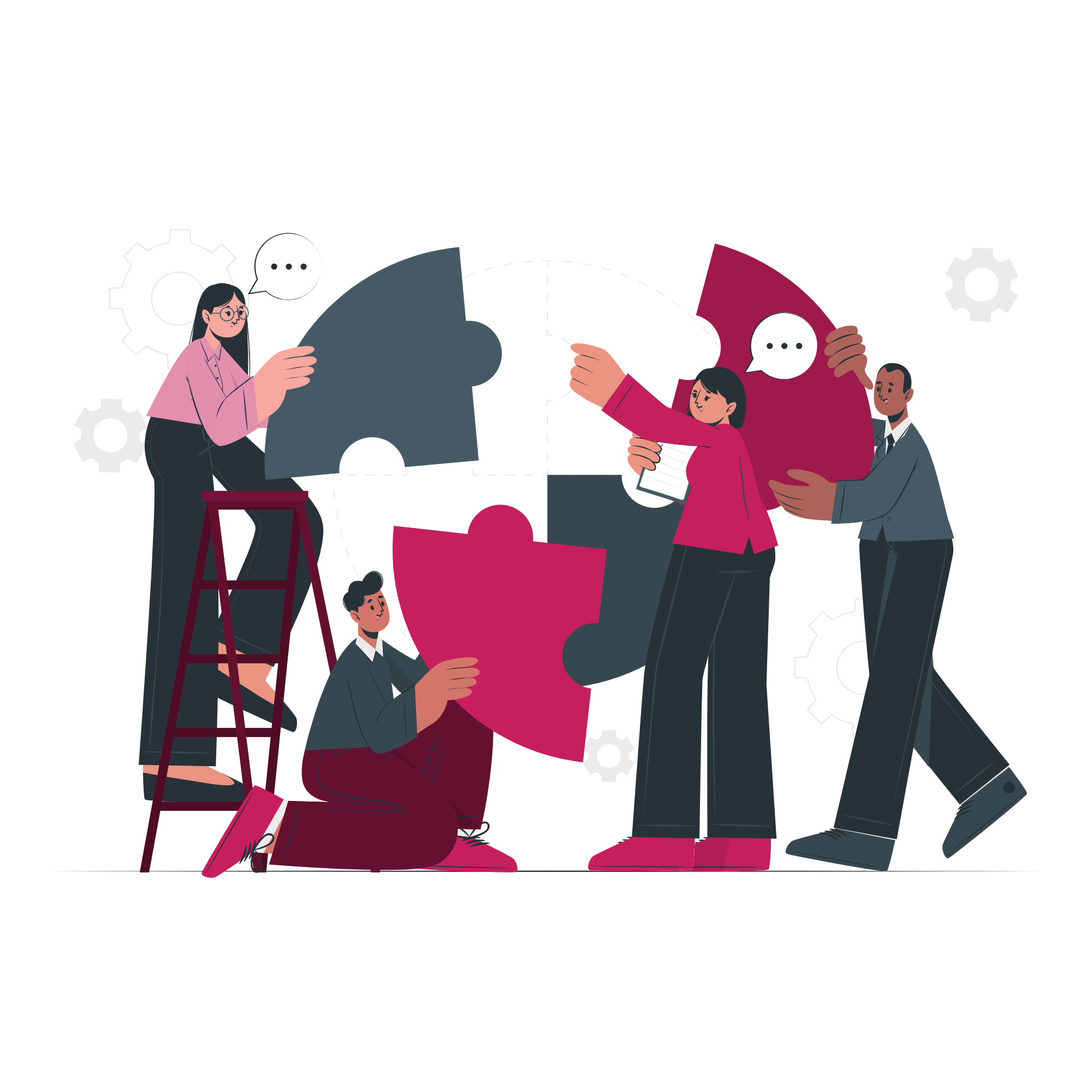
« Lorsque l’on se sent concerné et engagé par un sujet, on est naturellement motivé et l’on réalise un meilleur travail, car il a du sens. »
« Lorsque les équipes entretiennent des relations de travail apaisées, alignées, elles produisent de bien meilleurs résultats. »
« Les solutions sont souvent là, à côté de nous, mais nous pouvons ne pas les voir pour autant comme des solutions, car nous sommes conditionnés par des habitudes. »
Ces constats, vous les avez déjà sans doute réalisés.
Car beaucoup d’organisations, administrations comme entreprises, constatent aujourd’hui un désengagement des collaborateurs, des problématiques d’équipes qui empêchent le bon déroulement des projets.
Et ces organisations passent à côté d’opportunités d’innovations ou d’améliorations, chaque jour !
L’explication est dans la prédominance de pratiques professionnelles inadaptées (hyper-spécialisation des activités, formats collectifs non participatifs, manque d’autonomie dans l’action…) qui, fortement ancrées dans les habitudes, finissent par tuer la motivation, la prise d’initiatives et la participation.
Ces habitudes professionnelles, dans leur grande majorité, ne sont plus adaptées aux enjeux de notre société confrontée à des défis complexes, porteurs de changements majeurs et donc d’engagement personnel.
Les structures
Les structures conventionnelles régissent principalement nos activités professionnelles aujourd’hui comme l’a récemment relevé un rapport de l’Inspection Générale Interministérielle du secteur Social (IGAS).
Elles sont soit trop inhibitrices (présentations, reportings cadrés, discussions descendantes), soit trop désorganisées (discussions ouvertes et brainstorming sans cohérence dans la durée) et ne sont pas en capacité d’engager les personnes de manière créative et durable.
Une structure est finalement la façon dont les relations interpersonnelles vont s’organiser lorsque le travail est collectif.
Elle se compose de plusieurs dimensions :
- une question structurante en lien avec l’objectif poursuivi : une formulation de problématique, d’un enjeu…
- un agencement d’espace et du matériel. Format en U, absence de table, écran, support de présentation ou pas, post-it, board numérique : tous ces éléments interfèrent avec les personnes et vont orienter une façon spécifique de travailler ensemble
- la répartition de la participation : par exemple une présentation avec 100% du temps pour le présentateur ou au contraire un débat avec une participation partagée
- la configuration des groupes : binômes, petites équipes, groupe entier
- une suite d’étapes dans un temps donné qui correspond à l’ordre du jour ou à un déroulé minuté plus ou moins précis.
Exemple
La structure d’une réunion de suivi hebdomadaire pourrait ressembler à ceci :
- La question structurante : présentation des objectifs de la semaine
- L’organisation de l’espace : une table circulaire, projection d’un powerpoint
- La répartition de la participation : le responsable présente les objectifs sur 80% du temps et laisse 20% de la réunion pour des questions
- La configuration du groupe : groupe entier et présentateur
- La suite d’étapes : un déroulé sur 45 min (Les chiffres de la semaine passée / Les objectifs de la semaine / Questions)
Les structures libératrices
On peut donc agir sur ces cinq éléments structurels afin d’obtenir des résultats différents dans la contribution et l’engagement des collaborateurs.
Les structures dites « libératrices », en opposition aux structures conventionnelles, s’appuient ainsi sur les éléments structurels propices à la participation, à la co-construction et à la co-décision.
Elles sont des modèles qui cherchent explicitement à améliorer la coordination relationnelle, la confiance et la contribution.
Les structures libératrices favorisent rapidement la participation dans des groupes de toute taille, ce qui permet d’inclure et de libérer vraiment l’intelligence collective, comprise à la fois comme l’inclusion de tous et la capacité à générer des idées consensuelles et porteuses de sens.
Exemple
Pour bien comprendre les structures libératrices, on peut citer l’une d’entre elles, la structure “1-2-4-Tous” qui peut s’appliquer à plusieurs situations : recherche d’idées, échanges de pratiques, construction d’une vision collective, amélioration d’un processus.
“1” : La personne réfléchit seule pendant 2 minutes
“2”: Un échange en binôme permet de présenter mutuellement les réflexions individuelles en quelques minutes
“4” : En équipe de 2 binômes ou éventuellement de 3 (petites équipes de 4 à 6 personnes), on échange, on classifie, on choisit, on réfléchit. Plus l’équipe est resserrée, plus les échanges sont fluides.
“Tous” : La restitution de toutes les équipes permet de construire une vision collective à partir des idées exprimées dans les étapes antérieures.
Cette structure permet d’atteindre facilement l’objectif d’une participation de tous les collaborateurs puisque l’étape de réflexion individuelle et les petites unités d’échanges seront propices à l’expression des plus timides et des plus inhibés.
Ce schéma peut s’adapter, tout en excluant la seule version « en plénière » qui ne permet pas systématiquement une inclusion efficace de tous les participants, par exemple :
- individuel-groupe
- binôme-groupe
- équipe-groupe
- individuel-équipe-groupe etc…
Appliquer les structures libératrices par la pratique de terrain
Les structures libératrices sont assez simples et faciles à apprendre.
Elles peuvent être utilisées par tous, quel que soit son profil ou son métier.
Il n’est pas nécessaire de suivre de longues formations ou de faire appel à des talents particuliers. La maîtrise est simplement une question de pratique et passe par l’apprentissage de terrain, grâce à la participation à des séances avec des structures libératrices, puis progressivement grâce à l’intégration des structures libératrices dans ses propres animations.
Cette approche est très similaire à l’ambition d’innizio qui est de mettre les savoirs et pratiques de l’intelligence collective à la portée de chacun.
C’est la raison pour laquelle, l’équipe d’innizio a fait le choix d’intégrer progressivement les structures libératrices dans sa bibliothèque de ressources.
Conclusion
Si les dirigeants ont parfaitement conscience qu’ils peuvent considérablement augmenter la productivité et l’innovation en actionnant le levier de l’engagement et de la motivation, le défi principal pour eux est de savoir comment le faire.
Les structures libératrices proposent un chemin dont l’exigence n’est pas dans la compétence mais plutôt dans l’intention d’un changement profond.
Les structures libératrices sont en réalité une innovation de rupture pour les organisations qui souhaitent investir dans leur performance durablement en quittant des modèles structurants qui leur ont pourtant permis un développement et qui aujourd’hui les entravent.